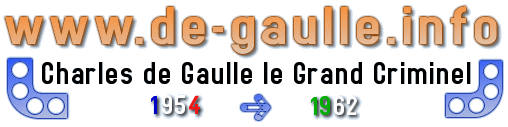Quels sont ces sauvages, où est la France ?
Le prétexte à cet écrasement enragé et hystérique était de chercher les
hommes de l’OAS, qui eux avaient filé depuis longtemps.
Le petit peuple de Bâb el Oued doit « payer ». Bâb el Oued, c’était
notre fierté. Bâb el Oued avait le goût de la vie.
De cela nous n’en parlons pas à cause des enfants qui veulent jouer avec leur
père. Nous restons silencieux, dans nos pensées.
Philippe me dit qu’un tract circule en ville, appelant toute la ville
à une marche pacifique, de solidarité, vers Bâb el Oued pour tenter de lever le
siège.
Et puis il est reparti pour se rendre chez IBM, boulevard Saint Saëns, où il
travaillait et il a peut-être, décidé de se rendre auparavant à la manifestation
en faveur des gens de Bâb el Oued. Cela je ne le saurai jamais.
On a retrouvé sa voiture sur les quais en raison des barrages et des cordons
de soldats, de gendarmes. Il a remonté le boulevard Baudin, le boulevard
Laferrière et il a marché vers le « plateau des Glières ». Il s’est trouvé pris
dans la nasse, dans le sac, dans ce guet-apens…de la Grande Poste... un vrai
traquenard... Un choix symbolique et stratégique pour une tuerie !... pour
massacrer ces pauvres combattants sans armes qui n’avaient que leur solidarité à
offrir et des drapeaux pour l’honneur...
Le plateau des Glières où se trouvait le Monument aux morts de ceux tombés
pour la France pendant les deux grandes guerres… Mon grand-père avait déjà donné
sa vie pour la France à Verdun en 1915. Il a mis des jours à mourir dans son
boyau plein d’eau, sans secours, intoxiqué par les gaz.
J’ai passé l’après-midi avec les enfants et je n’ai pas écouté la radio. Et
puis, le soir est venu avec le couvre-feu. Philippe ne rentrait pas.
J’ai téléphoné à mon père lui disant que Philippe n’était toujours pas
là, «s’était-il passé quelque chose» ? Mon père a poussé un cri, je crois, me
disant qu’il allait le chercher «il devait être pris dans les différents couvre-
feus» ?
Je ne sais pas comment j’ai fini de m’occuper des enfants, comment j’ai passé
cette nuit ? Je ne sais pas. Je n’en ai pas de souvenirs. Mais j’avais froid et
je suis allée chercher sa veste qui sentait l’Amsterdam, pour y dormir dedans.
Au matin, les enfants déjeunaient et mon père est passé devant la fenêtre de
la cuisine... alors j’ai compris…Il me semble que je tombe...les enfants crient…..et
puis je ne me souviens plus…..sauf que j’entre dans l’hôpital Mustapha et là une
autre moi se met à hurler que j’entendais de loin et qui m’assourdissait
pourtant. La douleur naissait au creux du ventre, montait en s’irradiant,
arrivait dans ma poitrine comme une brûlure intolérable et le hurlement
s’échappait tout seul de ma gorge avec mon souffle. J’ai couru m’enfermer dans
le service du docteur Sutter, chez qui j’avais fait un stage. Je ne me
souviens plus combien de temps je suis restée là à hurler.
Et puis on est venu me chercher pour m’amener dans une grande salle où des
corps tous nus étaient allongés, en vrac, par terre. Il fallait passer par-dessus,
c’était un spectacle effroyable, tous ces corps mutilés entortillés de bandages
au milieu desquels je le cherchais.
Philippe était dans une salle, habillé et il était allongé sur une table.
On l’avait donc amené vivant, et laissé mourir sur cette table? Il avait un gros
pansement sur le côté de la tête. Il n’était pas défiguré, il était lui. Je me
suis jetée sur lui alors que tout s’en allait de moi.
Je me suis mise à mourir. J’ai dû passer l’après-midi avec lui, le serrant
dans mes bras, l’embrassant. Et puis on m’a arrachée à lui. Et puis je ne sais
plus...Les jours suivants…les défaillances de ma mémoire me protègent sans doute,
encore aujourd’hui, des gouffres de l’horreur et de la douleur, de ces trous
noirs et béants où il n’est plus rien. Je suis retournée, au plateau des Glières,
place de la Grande Poste, avec Martine, ma fille. Je l’entendais qui
disait « maman a du chagrin, il faut la laisser », tandis que
j’embrassais chaque pavé où avait dû couler son sang.
Philippe, cité à l’ordre de la Brigade et à l’ordre du Régiment,
pendant son service militaire, pour avoir à chaque fois ramené ses hommes,
s’était fait tuer d’une balle dans la tête, de façon délibérée, par l’armée
française, comme on achève les chevaux ou plutôt un chien enragé. Achevé à bout
portant, il a vu la mort arriver. De quel côté se trouvaient donc les bêtes
sauvages ? Philippe, cité de façon élogieuse par cette même armée qui
parlait d’honneur, de courage, de valeur…Je n’ai pas besoin de consulter les
archives pour reconnaître dans cette sauvagerie et cette haine une volonté
délibérée, calculée, préméditée... La violence de cette cruauté sur lui, cette
mort humiliante infligée à un homme courageux et généreux, lui si généreux,
cette violence s’est emparée de moi. Je crois qu’on peut mourir de chagrin,
devenir fou, ne pas revenir…..
J’ai entassé tout ce qu’il y avait dans l’appartement, je voulais y mettre le
feu, mais je n’ai fait que tout casser. J’ai maudit la France pour sept
générations, j’ai supplié Dieu qu’il existe afin qu’il refuse à tous ces
gouvernants tout espoir de rédemption, j’ai prié de toutes mes forces pour que
ces donneurs d’ordre périssent par le feu, le fer et le sang, que ces faiseurs
de destins trahis au nom de la loi, que ces faiseurs de belles paroles, crachats
plein de pus, croupissent en enfer à jamais. J’ai invoqué la malédiction
définitive sur ma patrie, l’Algérie, et sur ce pays, la France, que j’avais tant
aimée à l’école. J’ai supplié que toutes les souffrances, des corps et des âmes
soient à jamais réservés à ceux-là : les entendre gémir, supplier, hurler de
terreur, courir de terreur…et mourir dans le caniveau... Je serai là, pour les
venger…..
Et puis je me suis arrêtée de hurler.
J’ai emmené les enfants au pays de leur père dont il était si fier. J’ai fait
la valise. Pour mes enfants et moi, ce n’était pas la valise ou le cercueil,
c’était pour nous, la valise –et – le cercueil... Nous n’avons pas trouvé les
Français, nous avons trouvé des gens qui ne nous aimaient pas.
Mes enfants eux étaient Français.
Nous l’avons ramené dans son pays. Je ne sais plus comment je me suis
retrouvée en Bretagne chez ses parents tout de suite après le 26 mars : tout
était interdit à Alger.
Nous avons attendu son cercueil pendant cinq horribles jours, ce cercueil qui
sillonnait la France depuis on ne savait quel port d’arrivée. Je crois me
souvenir que mon père avait tout acheté au marché noir. Il avait embarqué son
cercueil à la sauvette, dans la nuit, dans le couvre feu, sur le premier bateau,
en partance pour la France, qui l’avait accepté ; cercueil que la loi nous
interdisait d’honorer. Il a été inhumé le deux avril 1962, dans le petit
cimetière d’Arzon, dont fait partie Port Navalo. C’est sur « la tombe du petit
mousse » qui surplombe toute l’entrée du golfe du Morbihan que nous avions
échangé nos premiers serments si romantiques de ne jamais nous quitter et de
mourir ensemble.
Je me suis enfermée dans 42 ans de silence. Je n’ai plus jamais parlé. A
personne.
J’ai trouvé refuge auprès de ceux qui étaient dans la peine.
Aujourd’hui je peux témoigner de quelques souvenirs. Mes enfants ont grandi
dans la douleur de la disparition incompréhensible, indicible de leur père. Si
aujourd’hui le temps n’est plus des malédictions et des désirs de vengeance, si
l’héritage que je laisse à mes enfants est un héritage de douleur, ils sauront
le transformer, le reprendre à leur compte et accomplir leur destin où ils le
voudront et en être les maîtres. La fille de notre fille, notre petite-fille,
celle qui va avoir 22 ans, déjà, m’a rassurée : « je viens de cette
histoire, je l’aime, j’en suis fière et j’en prendrai soin ».
Le temps des historiens est venu et leur travail de vérité et de mémoire
m’est consolateur.
D’autres se sont battus, d’autres se battent encore.
Mais, pour moi, aujourd’hui, c’est toujours le temps des accusations, je «
les » accuse, car ils sont toujours là, d’assassinat, de meurtre prémédité sur
ces pauvres gens et sur la personne de mon mari. Je demande repentance.