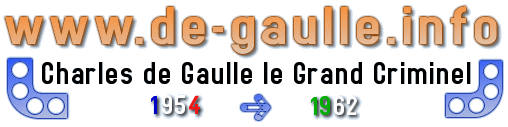Je suis prié de me
rendre le 8 janvier à l'Elysée pour la passation des pouvoirs. C'est le
matin. La cérémonie a lieu dans la grande salle, tous lustres allumés. Précédé
des huissiers en grande tenue, le président René Coty, ayant à ses côtés
Charles de Gaulle, fait son entrée. Après de brèves allocutions, les
Grands chanceliers passent au général de Gaulle le collier de l'ordre
de la Légion d'honneur puis celui de la Libération.
Le soir, à 17 heures, une cérémonie
est organisée à l'arc de triomphe. Après le dépôt de gerbes M. René
Coty monte en voiture en compagnie d'un familier puis, descendant Favenue
des Champs-Elysées, regagne dignement sa retraite
normande.
Tout ceci s'est déroulé très
vite et le protocole s'en est fâcheusement ressenti, mais l'on percevait le désir
du président Coty de mettre fin très rapidement à cet ultime devoir.
Quant au général de Gaulle, il avait hâte d'être seul.
Personnellement, j'ai été
touché par la grandeur d'âme du président René Coty. Je n'oublie
pas que, pendant mon commandement en Algérie, il n'a cessé de me soutenir.
Pourtant, le 14 mai 1958 j'ai enfreint les règles de la discipline en ne
diffusant pas son appel aux troupes. Il ne me l’a jamais reprochés me
disant même le 14 juillet suivant, lors de la réception à l'Elysée : «
Mon général, je vous remercie au nom de la France de ce que vous avez fait
pour elle. »
Ainsi, selon les déclarations
qu'il m'avait faites dans l'avion, le 2 octobre dernier, voici le général de
Gaulle président de la République... La France lui appartient désormais.
...
...
P.204
le général Koenig :
...
...
« Alors, Salan, me dit-il, cela doit vous coûter d'avoir quitté
notre chère Algérie. Le général de Gaulle avait fait pour vous une
entorse peu coutumière à ses résolutions! II a toujours été farouche
partisan de la séparation des pouvoirs, le civil ayant la primauté sur le
militaire. Et pourtant, vous étiez là-bas en train de gagner la partie...
« Vous allez donc loger dans ce gouvernement militaire que je connais bien.
Vous y découvrirez une chambre, dite de la duchesse d'Abrantès... Je ne sais
si le lit est authentique, quoique très style empire, toutefois je ne pouvais
pas y étendre mes jambes...
« L'appartement est agréable et vaste, mais pour aller aux toilettes (2) il
faut faire une véritable marche d'épreuve car cet endroit se situe au bout
du couloir qui n'en finit pas. Votre bureau est beau, vous aurez devant vous
toute l'esplanade des Invalides, et puis vous travaillerez sur la table de Murât.
« Puisque vous participerez aux grandes manifestations du régime — et Dieu
sait si elles sont nombreuses et trop souvent lassantes — nous aurons
l'occasion de nous rencontrer et j'en serai toujours heureux! »
...
...
Le travail s'organise et je ne
m'attends pas du tout au mauvais coup mijoté dans les coulisses. Le 10
février, mon chef d'état-major entre dans mon bureau le Journal
officiel du jour à la main et dirige mon attention sur la page 17975
à la rubrique : « Décrets, arrêtés et circulaires — Premier ministre
— Décret n° 59-262 du 7 février relatif aux attributions du chef d'état-major
général de la Défense nationale. »
Les huit premiers articles ont trait aux fonctions du chef d'état-major
nouvellement désigné, le général Ély, l'article 9 par contre est
ainsi rédigé en deux petites lignes : « Sont abrogées toutes
dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n°
58-1232 du 16 décembre 1958. »
Ainsi, d'un simple trait de
plume, l'Inspection générale de la Défense, à peine née deux mois avant
et selon la lettre même du 25 novembre du général de Gaulle,
n'existe plus! Je ne suis donc plus Inspecteur général de la Défense
nationale. Or, jusqu'à ce jour, tout me portait à croire que là seraient
bien mes fonctions essentielles, le poste de gouverneur ayant simplement
facilité l'installation de mes bureaux pour me permettre d'exercer les
attributions qui m'avaient été dévolues.
J'éprouve le sentiment profond
d'avoir été dupé... Je n'ai donc plus qu'à quitter ce service de l'État
où le mensonge semble devoir s'instaurer. Mes officiers et mes amis
s'empressent autour de moi pour m'en dissuader, m'assurant que l'Algérie a
toujours besoin de moi!
Je ne puis cependant encaisser
pareil camouflet sans réagir, aussi, le 10 février 1959, j'écris au général
de Gaulle. …..
...
...
P.207
Le 15 février, alors que je ronge mon frein, le général me répond :
« Mon cher Salan,
« Vous interprétez très
exactement mes intentions dans votre lettre du 10 février : je n'envisage pas
de vous écarter de la haute direction des affaires militaires,
« Mais la première formule choisie s'insérait mal dans le cadre des
nouvelles structures qui viennent d'être mises en place.
« Je vais vous faire nommer par décret membre de droit du Conseil supérieur
de la Défense. J'ai en outre l'intention de vous associer, en tant que de
besoin, aux délibérations gouvernementales touchant à la Défense nationale
et à la défense de la Communauté, par le biais du Comité de Défense.
« Je n'oublie pas les services que vous avez rendus au pays et vous conserve
toute mon amicale confiance.
« Croyez, mon cher Salan, à mes sentiments très cordiaux,.»
Je détiens l'original de
cette lettre.
Quelques jours après lorsqu'il
me reçoit, je proteste de nouveau fermement contre le sort qui m'est fait par
cette espèce de destitution officielle et publique. Le général fait effort
d'amabilité et dit :
« Détrompez-vous, Salan,
vous demeurez auprès de moi puisque vous êtes désormais membre du Conseil
supérieur de Défense, et vos fonctions de gouverneur militaire de Paris sont
revalorisées du fait de ma présence au sommet de l'État. Vous succédez à
des chefs exceptionnels tels que Gallieui et Gouraud, qui, comme
vous, ont eu un passé colonial historique. Ainsi que je vous l'ai écrit,
vous avez toute ma confiance. »
Sur ces mots le général me
tend la main. Je me retire assez « refroidi ».
Rentré à mon bureau je suis
l'objet de trop de pressions honnêtes et amicales pour abandonner ceux qui
m'ont sans cesse suivi sur des chemins difficiles, et qui n'ont, comme moi,
qu'un seul souci, qu'une seule préoccupation : maintenir l'Algérie dans la
France.
Je décide donc de rester, mais
me voilà sur mes gardes.
L'INQUIÉTUDE GRANDIT A
ALGER — ANNIVERSAIRE DU 13 MAI 1958-
P.212
Le Premier ministre, Michel Debré, qui en revient, fait un exposé.
N'a-t-il pas déclaré le 10 février à Alger même :
« L'Algérie est terre de
souveraineté française. Ceux qui y vivent sont des citoyens français. C'est
le droit, la réalité politique, la base de l'action.
« Mais c'est par notre activité dans le domaine économique, social et des
relations humaines qu'il faut chaque jour forcer la légitimité française. »
P.213 -214
En Algérie cependant certaines mesures de clémence prises par le nouveau président
de la République, en faveur de nombreux fellagha convaincus d'assassinats,
sont vivement critiquées. La conférence de presse qu'il tient le jeudi 25
mars à l'Elysée — c'est une première dans cette vieille maison et cela
constitue un événement — est amplement discutée. La rancœur à l'égard
du général est même exprimée publiquement et des envoyés du Mouvement
populaire du 13 mai viennent me demander d'intervenir. Je ne l'estime pas
utile présentement, mais, comme eux, je suis inquiet.
Un passage de la conférence de
presse a particulièrement troublé les populations à Alger.
« J'ai la conviction, dit en
effet le général, que l'Algérie et la France continueront à avoir une
histoire commune, A mesure que cette Algérie prendra sa figure et son âme,
son destin politique apparaîtra dans l'esprit et les suffrages de ses enfants.
Intellectuellement, socialement, moralement, l’Algérie est en gestation.
»
II devient indéniable que l'équivoque
s'installe sur le plan gouvernemental à Paris. Les propos tenus par Michel
Debré et ceux tenus par le général ne sont pas sur la même longueur
d'onde.
Le premier, lorsqu'il est à
Alger, parle de souveraineté française, de province d'Algérie. Le deuxième,
de Paris, déclare que l'avenir politique de l'Algérie « est en gestation ».
Comment ne pas reconnaître
qu'il y a là de quoi troubler ces gens qui ont peur d'être abandonnés et de
perdre le bénéfice de leur mouvement de mai 1958.
A quelque temps de là, je suis
l'hôte d'honneur du Cercle républicain que préside Robert Poulaine,
mon compagnon de l'époque Georges Mandel au ministère des Colonies.
J'ai à mes côtés le docteur Pierre Devraigne, nouveau président du
Conseil municipal de Paris, qui est mon grand ami, M. Georges Dardel,
président du Conseil général, les préfets de police et de la Seine.
L'assistance se presse nombreuse autour d'un déjeuner bien servi. A la fin du
repas, sous les applaudissements, il m'est demandé de prendre la parole.
« Nous ne devons pas perdre
la guerre d'Algérie, dis-je. Jamais l'armée ne permettra que nous
abandonnions ces départements, car la France ne serait plus la France et ce
serait nous priver des ressources énergétiques que procure notre Sahara. »
...
...
P.214 – 215
le général s'adresse à moi en ces termes :
"Pourquoi, Salan,
les Algérois, ces temps-ci, expriment-ils du mécontentement? J'ai apporté
à l'Algérie une aide économique exceptionnelle, j'ai renforcé les moyens
militaires, alors de quoi se plaignent-ils? Je les connais bien, depuis mon
arrivée à Alger le 30 mai 1943, et je les sais forts en paroles, mais je ne
comprends pas leur ressentiment actuel, que veulent-ils donc exactement de moi?
"
« Mon général, il est exact
que l'Algérie, sur le plan économique, connaît une période heureuse et nul
ne le nie. Sur le plan opérationnel, le général Challe marque de sérieux
progrès. Cependant, un fait trouble les Européens, c'est que vous ne preniez
aucune décision d'ordre politique. Votre conférence de presse de fin mars
leur donne à penser que l'Algérie et la France sont deux entités différentes.
Aussi s'inquiètent-ils de leur devenir. Comme ils ne représentent que le
dixième de la population, ils craignent d'être submergés par les Musulmans
et de voir l'action du 13 mai se retourner contre eux. »
« Bien, passons... »
...
...
P.221
C'est à Tizi-Ouzou, en pleine Kabylie, qu'il prononce ces paroles :
« Je crois percevoir de grandes
espérances et d'abord celle de la paix... »
« II faut en finir avec la pacification »,
dit-il aux cadres dans son
passage aux mess. Cela, c'est le langage pour les militaires.
« Les Algériens feront leur
destin eux-mêmes »,
ajoute-t-il aussi. En privé il
parle de trois options : la francisation totale du pays ; l'autonomie, la
France préservant quelques-uns de ses droits tels que ceux de l'économie ;
et l'indépendance... Car le mot est lâché, et, comme il y a toujours
des indiscrétions — mais le général ne les recherche-t-il pas ? —
d'aucuns s'abreuvent de ces derniers propos mais d'autres, et surtout les
militaires et les Musulmans fidèles, ne comprennent plus et s'étonnent
d'être ainsi traités.
A la différence du chef de l'État,
et pour ajouter à la confusion des esprits, à Paris, Michel Debré déclare
à la presse :
« Si la France quittait l'Algérie,
ce serait aussitôt la guerre civile. »
Après cette première tournée
dite « des popotes », je reçois de
nombreuses lettres ou visites tant d'officiers que de civils.
p.222
Les termes de la conférence de presse radiotélévisée du 16 septembre, où
le général reprend les trois postulats déjà confiés en catimini à un sous-préfet
d'origine musulmane de Tizi-Ouzou, vont ajouter à leur détresse.
Cette fois c'est officiel et les
passions vont se déchaîner.
En effet, au cours de sa conférence,
le général développe pleinement sa pensée, en particulier l'autodétermination
des Musulmans. Pour ceux qui se battent depuis 1954, pour ceux qui ont fait le
13 mai 1958 et pour tous les Musulmans qui nous ont suivis, c'est la condamnation
sans réserve et le F.L.N. reprend l'espoir de gagner la partie.
Soir de deuil à Alger et dans toute l'Algérie où les conversations vont bon
train.
Qu'allons-nous devenir ? Que va
faire l'armée ?
Le maréchal Juin, enfant
de Bône, et mon voisin actuel puisqu'il occupe les bureaux situés sous mon
appartement des Invalides, me fait prier de me rendre auprès de lui.
Il est très ému et me dit :
« Où allons-nous, Salan?
Je ne puis laisser passer cette conférence de presse sans réagir sur le plan
personnel. »
Je l'en remercie et, le 26
octobre, après mûres réflexions, le maréchal prend position dans un long
article donné au journal Aurore et dont voici les passages essentiels
:
« N'est-il pas outrageusement
surprenant que la Tunisie et le Maroc ne tentent rien pour désarmer les
bandes hostiles ?
« L'ennemi est installé en France aux aguets...
II serait grand temps, si l'on
tient à ce que la pacification soit accélérée, qu'on y portât remède en
songeant au sang français qui coule et au malheur qui s'est abattu
depuis cinq ans sur les laborieuses et pacifiques populations algériennes...
« Ne laissons pas, de grâce, se détériorer les situations sous l'effet
d'un terrorisme larvé et du doute qu'on fait planer sur nos intentions. La
masse des Musulmans raisonne comme le centurion de l'Évangile..."Domine
non sum dignus itt intres sub tectum tneum, sed tantum die verbo et sanabitur
anima mea"
(Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites
seulement une parole et mon âme sera guérie.) et est en droit de craindre
qu'en Algérie, comme ailleurs, nous n'abandonnions nos amis.
« II faut donc qu'il soit bien
convenu qu'aucun acte ne pourra être accompli par la France qui puisse semer
le doute dans l'âme déjà fort troublée des Algériens français et
musulmans. »
Le maréchal laisse parler
son cœur. C'est le grand chef de guerre soucieux des hommes qu'il a menés
dans la bataille, qui lui ont fait confiance et qui l'ont suivi, qui s'exprime
:
« Voilà le vœu que forme pour
ses frères algériens, français et musulmans, un vétéran de l'armée
d'Afrique, qui a grandi dans son sein et qu'elle n'a cessé d'abreuver de
fierté, un vieux soldat qui compte actuellement dans sa famille quatre générations
de Français de souche qui se croyaient jusqu'ici indéfectiblement attachés
à l'Algérie, leur vraie patrie. Il serait désespérant de voir un jour la
France ramenée dans ses frontières de 1815, à la chute de Napoléon, avec toutes
les conséquences malheureusement prévisibles d'un pareil abandon. »
Dès que j'ai connaissance de
cette déclaration, je me précipite chez le maréchal. Nous nous étreignons,
fort émus, mais inquiets du devenir de cette Algérie que nous, nous ne
cessons de vouloir sauver.
Ce communiqué, rapidement
diffusé chez nos cadres et dans les cités, apportera un peu de calme à la
population, bien que les craintes demeurent à cause de la position prise par
l'Elysée.
...
...
P.235 – 236 - 237
Que va donc faire le commandement d'Alger, le général Coste et le
colonel Fonde ? Ils donnent tout bonnement l’ordre de charger et de
faire dégager le terrain où la foule s'est rassemblée. A 17 h 45, la
colonne, aux ordres du colonel Debrosse, s'ébranle d'un pas lourd.
Tout le monde se met en alerte et les territoriaux envoient quelques cadres
faire refluer les civils vers le bord de mer pour dégager leur champ de tir.
Cela demande un certain temps.
C'est alors qu'à 18 h 10, les
gardes, sans faire de sommations, foncent à partir du boulevard
Pasteur en appuyant leur mouvement par des jets de grenades lacrymogènes.
Deux inspecteurs, qui ont été chargés de prendre la tête de la colonne s'y
sont refusés faisant valoir que le P.C. des territoriaux est en contact avec
le commissariat central qui a, en effet, placé à la Compagnie algérienne
deux des siens pour surveiller la manifestation, et que, par ailleurs, ils
n'ont reçu aucun ordre de leurs supérieurs hiérarchiques pour faire les
sommations...
Il se produit alors un incident.
Dans la foule, un homme dont
l'identité ne pourra jamais être découverte, tire un coup de feu en l'air,
à côté du restaurant le Paris.
Sans sommations encore, je le
répète, les gardes ouvrent le feu.
Les territoriaux ne peuvent
riposter tout de suite car il y a toujours des civils entre eux et les forces
de l’ordre. Ce n'est qu'à 18 h 20 que leurs fusils mitrailleurs entrent en
action et font de gros dégâts à la colonne qui charge, particulièrement
sur la place de la Poste.
De tous côtés on essaye d'arrêter
le feu, mais seule l'arrivée des parachutistes permettra d'y parvenir. En
effet, le Ier R.E.P. du colonel Dufour, venant par le tunnel des Facultés,
et le Ier R.C.P., arrivant par le boulevard Baudin, encadrent le plateau des
Glières. Il était temps que le drame de cette journée se termine!
Ces coups de feu que j'ai
entendus de Paris ont été pour moi un vrai déchirement! Le bilan en est
tragique, treize gendarmes, dont deux officiers, et six civils tués, cent
dix-sept gendarmes et vingt-quatre civils blessés, soit cent soixante
personnes tuées ou blessées !
A quoi l'attribuer ?
Tout d'abord aux ambiguïtés
de la politique algérienne du général de Gaulle, mais ensuite aux
regrettables erreurs du commandement local. Les uns et les autres n'étaient
pas sans connaître le degré d'exacerbation auquel était parvenue la
population d'Alger qui vivait dans la peur d'être abandonnée.
Pourquoi ne pas être allé vers
elle ?
Qu'a fait le délégué général?
Rien! Je n'ai pas connaissance qu'il se soit manifesté publiquement dans les
tractations sans nombre qui ont marqué cette pénible journée.
Pourquoi ne pas avoir essayé de ramener le calme, ne pas être allé au
contact, puisqu'il apparaissait qu'il y avait risque d'émeute dans la rue? On
n'a même pas aperçu son ombre...
Et pourtant, il assumait à lui
tout seul l'entière responsabilité politique avec sous sa coupe le chef
militaire qui tenta, pour sa part, mais sans succès, de calmer les esprits.
Je connais le général Coste,
d'origine « pied-noir »s et le colonel Fonde qui, coloniaux comme moi,
ont été sous mes ordres en Indochine où ils se sont fort bien comportés.
Mais à les juger sur les événements de cette journée, je ne puis être
tendre à leur égard. Je suis d'autant plus étonné du comportement de Coste
qu'après le 13 mai il était venu me remercier des services que je venais de
rendre à sa terre d'origine. Il devait bien connaître, tout de même, ses
compatriotes!... Ceci c'est le plan moral.
Dans le domaine tactique, je
note chez Coste et Fonde une méconnaissance totale du combat de
rue, dans lequel il faut toujours essayer de parlementer, le militaire étant
couvert par le commissaire de police. On n'envoie pas un colonel de
gendarmerie au devant de la foule, on y va soi-même et on essaye de la
raisonner, surtout si des contacts ont été établis antérieurement, comme
ce fut le cas entre Coste et Ortiz. De surcroît les gardes, qui
avaient été prélevés dans différentes unités, ne formaient pas une unité
cohérente, ce qui est une faute, car pareille troupe échappe souvent au
commandement qui la connaît mal, et pourquoi ce triage ?
D'autre part puisqu'on engageait
le 1er R.E.P. et le 1er R.C.P. sur le flanc droit des gardes, pour encercler
les manifestants par deux avenues descendant au plateau des Glières, il était
indispensable de minuter exactement le rendez-vous, l'arrivée sur place des
paras, enfants chéris d'Alger, avant les gardes aurait évité tout coup de
feu... Or ce n'est que trois quarts d'heure plus tard qu'ils arriveront.
Il y a là une faute capitale,
et quelle erreur sur le plan humain! C'était un beau dimanche de janvier et
les Algérois, qui viennent avec leurs familles sur ce plateau qui leur est
sacré, n'ont nullement l'intention d'envahir un quelconque bâtiment public. Pourquoi
alors donner l'ordre de charger? La journée touchait à sa fin, il
faisait presque nuit et, venus très souvent de loin, les manifestants, avec
femmes et enfants, se seraient dispersés d'eux-mêmes.
Dans ce genre de manifestation,
le chef doit savoir maîtriser ses nerfs et faire preuve de sens humain.
Combien je déplore ce lourd bilan qui pèsera sur l'avenir! Une nouvelle page
de l'histoire de l'Algérie s'ouvre et elle menace d'être amère.
A la suite de ces événements
j'estime de mon devoir de prendre position et rédige une lettre pour le général
de Gaulle :
Paris, le 26 janvier 1960.
« Mon Général,
« Au moment où des événements tragiques particulièrement lourds de conséquence
ensanglantent notre terre
...
...
P.239 - 240
Le général Jouhaud signe cette lettre avec moi.
A 11 heures, ce mardi 26 janvier,
le colonel Juille la porte à l'Elysée, elle est immédiatement remise
par un officier du cabinet à son destinataire. Il m'en est rendu compte à
midi.
Je descends alors voir le maréchal
Juin, lui explique ce que je viens de faire et lui tends une copie de
la lettre.
Je le sens troublé à sa lecture... Il est assis, ses jambes se croisent et
s'entrecroisent... Il la relit une nouvelle fois, me regarde droit dans les
yeux, et me dit :
« Merci, Salan, je vous
comprends trop bien! Où allons-nous? Mais... Il va vous foutre à la
porte! »
Je le quitte sur ces derniers
mots.
...
...
« Bombardez-les avec nos avions, faites foncer nos chars ! » dit André
Malraux.
MM. Jacques Soustelle et Bernard
Cornut-Gentille expriment alors leur désaccord.
La radio parle de ma mise à la retraite. Ce qui est certain, c'est que je
suis devenu l'objet d'une surveillance policière particulièrement
serrée. M. Cornut-Gentille ministre des P.T.T., me prévient de faire
attention à mes conversations téléphoniques, car je suis branché sur une
table d'écoute. Je m'en doutais, mais le remercie de sa confirmation. Le
lendemain, le ministre des Armées, M. Guillaumat, me prie d'aller le
voir en fin de matinée.
« Vous avez écrit au général
une lettre dont il n'est pas satisfait » , me dit-il.
Je réponds tout simplement :
« Je n'ai fait qu'exprimer les
sentiments auxquels je demeure fidèle...
Je reviens d'Alger. Ce que j'ai vu n'est pas réjouissant! Avez-vous une
solution?
Pour moi, il n'y en a qu'une, il suffit que le général de Gaulle
prenne une position nette et déclare, comme il me l'a écrit en son temps,
« nous ne lâcherons pas l'Algérie
».
Le ministre., alors, lève les
bras au ciel.
« II ne le fera pas! A la grâce
de Dieu maintenant! »
P.245
Le 13 février à Reggane,le champignon nucléaire monte dans le ciel du
Sahara.
...
...
Cette explosion est malheureusement suivie d’une action de mauvaise humeur
à l’égard de l’Algérie. En Conseil des ministres, le gouvernement décide
la dissolution des unités territoriales. Les attributions préfectorales
assumées par les officiers depuis le 13 mai 1958 leur sont retirées, de plus
les services de police dirigés jusque-là par le colonel Godard
passent directement dans les mains de Paris.
Des mutations interviennent, les
généraux Faure, Gribius et Mirambeau, ces deux derniers
anciens compagnons de Leclerc, sont rappelés en métropole ainsi
qu'une bonne vingtaine d'officiers.
La justice militaire est réorganisée
et le service d'action psychologique supprimé.
Nous assistons en fait à une démolition
complète de ce qui avait permis à l'Algérie, après le 13 mai, de connaître
des jours d'espoir et de progresser vers un avenir constructif dans une
heureuse symbiose de l'Européen et du Musulman.
Toutes ces perturbations pèsent
sur le climat issu des douloureuses journées de janvier. C'en est fini de la
confiance pourtant retrouvée à la suite des efforts de tous au cours des années
1957 et 1958. Le général, prévenu, n'en a cure et décide enfin
d'effectuer un voyage en Algérie, ce qui ne s'était pas produit depuis le
mois d'août 1959.
Il évite Alger, son but étant
de parler aux militaires de l'intérieur. Challe l'accompagne.
...
...
P.746
Après avoir atterri à Telergma, passé par Collo au 3e régiment étranger
d'infanterie, puis par Catinat, il arrive à El Milia où commande le colonel Trinquier
qui le reçoit. Il importe de noter particulièrement les paroles qu'il y
prononce:
« Ce que Ferhat Abbas
appelle l'indépendance c'est la misère, la clochardisation, la catastrophe.
Je ne crois pas que les Algériens choisissent cela. La France ne doit pas
partir. Elle a le droit d'être en Algérie, elle y restera. Aux
militaires de faire que nos armes l'emportent. »
Les cadres et la troupe boivent
ces paroles...
C'est ensuite la région de
Tlemcen qui l'accueille et c'est alors la stupeur chez nos cadres, car ils ne
retrouvent pas les paroles prononcées dans l'Est Algérois. Voici en effet ce
que peuvent entendre les personnes présentes :
« Ce sont les Algériens qui décideront,
et je crois qu'ils seront partisans d'une Algérie algérienne liée à la
France. »
Or, tout ce qui se dit à
Tlemcen a une résonance indiscutable dans le monde arabe, en raison de
l'importance religieuse de cette cité.
Le colonel Trinquier,
troublé, m'écrit qu'il est abasourdi par ce changement d'attitude ; les
cadres n'y voient plus très clair, on parle même, concernant le chef de l'État,
d'artifice et de ruse. Comment, d'ailleurs, ne pas s'interroger quand
on ne comprend plus... Le militaire ne peut vivre constamment dans les
malentendus, il lui faut des situations nettes, précises, or le général ne
cesse de le promener de « l'espoir à la défiance» de souffler tour
à tour le chaud et le froid...
Je m'en attriste à l'approche
de mon départ à la retraite d'autant plus que je reçois sans cesse des
lettres où on me demande de prendre position, ce que je ferai au congrès des
combattants de l'Union française qui doit se tenir le 5 juin, dimanche de
Pentecôte, à Rennes.
A la suite de la récente visite
du chef de l'État, le général Challe quitte l'Algérie, il est
remplacé par le général Crépin, gaulliste du début.
...
...
P.251
Je retrouve, pour mes dernières journées, l'hôtel des Invalides ; le mardi
suivant, vers 10 heures, le téléphone sonne, je décroche et voici la
conversation qui s'engage :
— Allô, général Salan? Ici, général Ély...
— J'écoute.
— Mon général, je viens de lire dans la presse un résumé de la motion de
synthèse du congrès de Rennes que vous présidiez, ainsi que vos déclarations.
N'estimez-vous pas que la position que vous avez prise publiquement est de
nature à importuner le général de Gaulle, à le gêner dans
sa politique algérienne, à lui être désagréable?... Vous déjeunez
demain à l'Elysée, ne pensez-vous pas que vous allez vous trouver en
situation fausse devant le chef de l'État?...
— Non, mon général, rentré en France depuis un an et demi, je n'ai cessé
de prôner la cause de « l'Algérie française », je l'ai fait en
public ne cachant jamais mes sentiments, je ne vois pas en quoi je puis me
trouver en situation fausse devant le général.
Comme convenu, je me rends avec
mon épouse et mes plus proches collaborateurs à son invitation, ceci en
toute liberté d'esprit et sans aucune appréhension.
Le mercredi 8 juin, à midi trente, j'arrive à l'Elysée, le Conseil des
ministres vient de se terminer, le général m'accueille en veston dans son
bureau et me fait asseoir en face de lui.
— Ainsi donc, Salan, vous nous quittez, me dit-il.
— Mon général, j'ai 61 ans le 10 juin, c'est l'âge de la retraite pour
mon grade.
— Effectivement, à ce sujet, laissez-moi vous donner un conseil, ne vous
lancez pas dans la politique, la politique salit son homme. Gardez-vous
prêt pour une tâche que je désire vous confier depuis longtemps, je vous en
ai déjà entretenu, j'aurai besoin de vous pour une mission d'amitié avec la
Chine de Pekin.
...
...
P.253
A 15 heures, le colonel de Bonneval nous fait signe de nous retirer, ce
sera mon dernier contact avec le general de Gaulle, je ne le reverrai
plus.
P.259 et suivantes
J'ai bien cru que nous garderions l'Algérie, où nos jeunes ingénieurs,
depuis le plan de Constantine du 3 octobre, faisaient merveille et construisaient
une Algérie nouvelle. J'ai bien cru aussi, et j'ai tout fait dans ce but,
que nous garderions « notre » Sahara, et voilà que tout est fini...
Tous ces hommes, soit près de
trois millions qui sont passés par l'Algérie de 1952 à 1960, sont les représentants
de cette merveilleuse jeunesse. Ils ont tout fait pour amener le Musulman
à la France, pour souder les deux communautés, ils ne comprennent plus
ce retard à leur attribuer la carte du combattant, ils ont le sentiment
d'avoir œuvré en vain, d'avoir été frustrés d'une victoire qui s'annonçait,
de s'être battus pour rien...
Car c'est le 16 septembre 1959,
dans sa conférence de presse, que le général de Gaulle laisse éclater
sa véritable pensée. Devant un immense parterre de journalistes à
audience nationale et internationale, il développe son dessein de l'Algérie
algérienne... Désormais, inexorablement, inlassablement, il le
poursuit, tout en donnant aux troupes l'ordre de
se battre sans répit, semblant oublier que des hommes meurent,
pendant que ses envoyés personnels, en Suisse, les frappent dans le dos.
Personnellement, à Paris, je
continue à me battre pour la cause de l'Algérie française. Au cours des
dix-huit mois écoulés, dans les manifestations que j'ai présidées et
auxquelles j'étais convié, j'ai sans cesse répété que la France ne
pouvait se concevoir sans l'Algérie, notre Sahara et son pétrole.
Je n'ai jamais caché mes
opinions que j'ai toujours exprimées sans ambages, ainsi qu'on peut le lire
dans le dernier chapitre de cet ouvrage. L'Elysée ne pouvait donc l'ignorer,
je parlais en tenue, aucune observation ne m'a été faite. Pourquoi
? C'est à n'y rien comprendre !
J'en ai découvert le mystère
dans Les "Mémoires d'espoir", "Le renouveau 1958-1962",
du général de Gaulle. J'y trouve, me reportant aux passages concernant
l'Algérie et sur ma personne des mots étonnants qui contredisent tout
ce que le général a proclamé publiquement en 1958 et au début de 1959,
ou dans sa correspondance personnelle, d'où l'intérêt des lettres que je
donne en fac-similé à la fin de ces réflexions.
« Ma décision
d'accorder aux Algériens le droit d'être maîtres d'eux-mêmes a tracé la
route à suivre...»
Mais plus haut il écrit,
relatant sa prise de contact avec l'Algérie les 4, 5 et 6 juin :
« Vers 7
heures du soir j'arrive au Forum.
Quand je parais au balcon du gouvernement général, un déferlement inouï de
vivats soulève l'énorme foule qui est rassemblée sur la place. Alors en
quelques minutes, je lui jette les mots, apparemment spontanés
dans la forme, mais au fond bien calculés, dont je veux qu'elle
s'enthousiasme sans qu'ils m'emportent plus loin que je n'ai résolu
d'aller. Ayant crié « Je vous ai compris ! » pour saisir le contact
des âmes, j'évoque le mouvement de Mai auquel je prête deux mobiles, nobles
entre tous : rénovation et fraternité. J'en prends acte et déclare qu'en
conséquence la France accorde l'égalité des droits à tous les Algériens
quelle que soit leur communauté. »
Et poussant plus loin, je lis :
« Pendant
mon inspection, j'ai à mes côtés le général Salan, commandant en
chef et chargé des pouvoirs civils. Il est, de par son caractère, très au
fait des troupes et des services et, en vertu de son expérience aussi bien
que de ses goûts, fort à son aise dans ce complexe de renseignements exploités
et interprétés, d'intelligences entretenues chez les adversaires,
d'entreprises feintes pour les tromper, de pièges tendus à leurs chefs, qui
enveloppe traditionnellement les expéditions coloniales...
En somme, son personnage,
capable, habile, et par certains côtés séduisant, comporte quelque chose
d'ondoyant et d'énigmatique qui me semble assez mal cadrer avec ce qu'une
grande et droite responsabilité exige de certitude et de rectitude. Mais, déjà,
j'envisage de lui donner un autre emploi avant longtemps".
Or, c'est ce même 6 juin, où
le général a ses réflexions intérieures à mon sujet, qu'il me donne
tous les pouvoirs et fait de moi non seulement le commandant en chef des
forces mais aussi le délégué général, poste éminemment important !
Pourquoi, le 3 octobre,
à l'issue du rassemblement de Constantine, puis le 24 octobre, le 25 novembre
et le 12 décembre dans ses lettres, enfin dans son speech au moment de mon départ
de l'armée le 8 juin 1960, me couvre-t-il de fleurs en termes si élogieux?
Pourquoi m'avoir laissé
la responsabilité algérienne à l’échelon local pendant sept mois
? Avant longtemps ne signifie-t-il pas bientôt, sous peu?
J'estime avoir le droit
d'exprimer ce que je ressens. Comment expliquer tant de revirements, de
foucades imprévues que les faits attestent tout au long de cet ouvrage
?
Pourquoi tous ces manquements
aux engagements les plus solennels, aux propos rassurants sur l'Algérie,
qu'il me tenait en privé ?
En relisant les pages que je
viens d'écrire, je ne puis m'empêcher de penser à l'Indochine. Tandis que
nos hommes se faisaient tuer par ordre de Paris dans la funeste cuvette, on
négociait à Genève, Dien Bien Phu capitulait en mai, désastre
militaire sans précédent dans nos campagnes coloniales, les meilleurs officiers,
nos meilleurs bataillons tombaient ou finissaient prisonniers dans les
camps de la mort du Viêt-minh.
En Algérie, ordre est sans
cesse donné de se battre jusqu'au bout, mais dans une villa isolée
de Suisse, des emissaries touchant de très près le général de
Gaulle s'assoient autour d'une table avec les délégués des fellagha.
Étrange coïncidence, « on nous refait le coup de l'Indochine ».