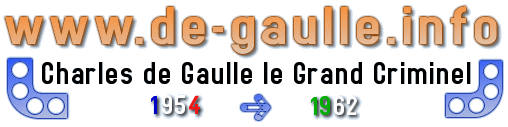|
Le Bilan
Du Gaullisme
Partie
3 -
L'Application de la doctrine… |
V. -
L'Application de la doctrine
Telle est la doctrine que de Gaulle formule dès 1932, et qui prend
l'allure d 'une confession anticipée. Le Chef plein de prestige, entouré de
mystère, mélange « d'égoïsme, d'orgueil, de dureté et de ruse » qui
violente l'âme des foules et façonne l'histoire, il le sera et s'y prépare. Il
convient de lire le livre de Henri de Kérillis
"De
Gaulle dictateur
"(Beauchemin,
Montréal, 1945) pour en avoir, l'application.
Je ne partage pas l'avis de M. de Kérillis sur l'armistice. L'armistice
fut la réaction spontanée de la logique française. Depuis le 16 mai , il était
évident que la guerre était perdue pour nos armes et les cinq semaines de combat
qui suivirent ne furent qu'un baroud d'honneur, que la France offrit à la
majesté de son histoire. Continuer la lutte en Afrique du Nord, comme devait
l'avouer M. Churchill au général George, n'eût abouti qu'à perdre
la Méditerranée et à prolonger sans fin la guerre entre l'Empire britannique et
le Reich.
A partir du 12 juin, il n'y avait plus choix pour la France qu'entre la
capitulation et l'armistice; mais ce choix, que ni la Pologne, ni la Norvège, ni
les Pays-Bas, ni la Belgique n'avaient eu, lui restait.
La capitulation était interdite par le code de justice militaire. Elle eût livré
tout le territoire métropolitain à l'envahisseur, qui aurait installé des bases
navales et aériennes sur les côtes de Provence, d'où il aurait pu bombarder
impunément les villes sans défense de l'Afrique du Nord et ravitailler sans
difficulté l'Afrika-Korps. Entre deux maux, la logique française exigea de
choisir le moindre : celui qui sauvait l'Empire, une partie du territoire
métropolitain, un rudiment d'armée, et la flotte. L'armistice répondit à un
mandat impératif de la volonté nationale.
Il fut plébiscité par le voeu unanime des populations. Le Maréchal, comme
l'a écrit de Monzie dans son journal, fut vraiment en ces jours de
désastre, l'officiant d'une messe de désespérés.
L'Assemblée nationale, en lui déléguant le pouvoir constituant, fut à peu près
unanime à reconnaître le bien-fondé de l'armistice, Edouard Herriot,
incarnation du républicanisme, déclara : « Autour du maréchal Pétain,
dans la vénération que son nom inspire à tous, notre Nation s'est groupée dans
sa détresse. Prenons soin de ne pas troubler l'accord qui s'est établi sous son
autorité. » En décembre 1941, lorsque la général Odic, chef d'Etat-Major
de Weygand pendant son Proconsulat d'Afrique du Nord, vint à Londres se
mettre à la disposition du général de Gaulle, une des premières choses
que celui-ci lui dit fut : « N'avouez jamais que l'armistice ne pouvait
être évité »
Je ne partage pas non plus l'avis de M. de Kérillis sur le rôle joué par
la Cagoule. Quand on demande à une hypothèse d'expliquer tout, elle finit
par n'expliquer rien. M. de Kérillis voit la Cagoule partout : à
Vichy, à Londres, à Alger, une Cagoule qui mise sur tous les tableaux
pour être sûre d'être gagnante. Qu'il y ait eu des Cagoulards à Londres
et à Vichy, qu'il existe une franc-maçonnerie cagoularde, je l'avoue. Que
l'entourage du Général ait été un mélange hétéroclite et détonnant, composé
d'ingrédients les plus divers, rien n'est moins contestable. Mais, voir dans les
agissements d'une société secrète la clé de tout ce qui s'est passé, c'est trop
simplifier. Il en est comme de la synarchie, variante du complot cagoulard, par
où l'on a voulu expliquer l'armistice et les réformes de Vichy. La synarchie,
dans la tradition du Saint-Simonisme ne fut que l'élucubration
innofensive de quelques Polytechniciens technocrates groupés autour de Jean
Coutrot. Elle est à classer parmi les innombrables plans, inspirés des Etats
totalitaires, où un De Man et un Déat voyaient la solution des
maux de leur temps.
Ces réserves
faites, le livre de M. de Kérillis demeure un des plus grands
réquisitoires de l'histoire, qui mérite de figurer à côté de l'Histoire
d'un Crime de Victor Hugo et de J'accuse de Zola. Les faits qu'il
avance sont confirmés : du côté français, par la lettre du général Eon,
par le du général Odic, par la dossier d'André Girard; du côté
américain, par Kenneth Pendar, un des vingt vice-consuls de Murphy,
dans un ouvrage capital, Adventure In Diplomacy, our French Dilemma
(Dodd, Most and Co, New-york) par le Diary du capitaine Harry C.
Butcher, sécrétaire d'Einsenhower, paru dans Collier's
(janvier et février 1946); du côté anglais, par les discours de M. Churchill
aux sessions secrètes des Communes, parus dans Life (27 janvier et 4
février 1946), par son mémorandum contre de Gaulle; par les révélations
de Kenneth de Courcy, secrétaire du parti conservateur, dans Review of
World Affairs (octobre, novembre, décembre 1945, janvier, février 1946). De
ce faisceau de témoignages se dégage la physionomie assez précise d'un
apprenti-dictateur qui devint, par manque de caractère et de capacité, un
apprenti-sorcier.
VI. - L'application de la doctrine ou la guerre à Vichy
pour la conquête du pouvoir
« La merveilleuse histoire du général de Gaulle » est la lamentable
aventure d'un grand destin trahi par une incommensurable vanité. C'est
l'histoire d'un homme médiocre, dont la B. B. C., les avances du trésor
britannique, une propagande effrénée, l'anthropomorphisme des foules, l'apathie
des tièdes, l'astuce des ambitieux, ont fait un homme-symbole.
C'est l'histoire d'un militaire qui, pour avoir lu la Technique du coup
d'Etat de Malaparte, voulut jouer au politique et rêva d'un 18
Brumaire; brutal tant qu'il eut la force, plein de grandiloquence et de
rodomontades, puis sentant soudain « le coeur lui manquer » à l'heure du défi,
c'est l'éternelle histoire du mystique devenu cynique qui, s'identifiant avec la
France tout comme Louis XIV disant : « l'État c'est moi » ramena
le salut de sa patrie à son avènement au pouvoir, justifia l'absence de scrupule
du choix des moyens par la noblesse de la fin poursuivie; mobilisa au service de
son ambition personnelle la foi des sincères, l'héroïsme des militants, le
dévouement des purs que ne justifiaient, envers lui, ni les risques courus, ni
les sacrifices consentis, ni le génie politique, ni la rigueur d'une âme
inexpugnable, que visite un intransigeant idéal.
La résistance, sous forme de guérilla à l'intérieur, de légions de combattants à
l'extérieur, fut la réaction spontanée et unanime de tous les pays subjugués par
l'Allemagne. Elle exista en Pologne, en Norvège, en Hollande, en Belgique, en
Grèce, et elle eût existé en France, comme partout ailleurs, même si l'avion du
général Spears ne se fût pas trouvé pour ramener au Premier Ministre
britannique le général de Gaulle. En deux ans avec des milliards de
francs-or, de Gaulle parvint seulement à mobiliser onze mille hommes,
dont la plupart des indigènes, alors qu'à l'appel de Giraud, en quelques
mois, plus de trois cent mille hommes répondirent à l'appel des couleurs. Si
de Gaulle symbolise aux yeux des Français la Résistance, cela est dû surtout
à cette brillante pléiade de commentateurs, Bourdan, Duchesne, Oberlé,
Shumann, dont on ne dira jamais trop combien ils soutinrent le moral et
vivifièrent l'espoir d'une France bâillonnés, et à l'habile diplomatie d'un
Emmanuel d'Astier de la Vigerie.
Le
piètre résultat de l'appel du général de Gaulle est attribuable à un faux
départ. Dès le début, on trouve dans son cas l'équivalent de la mystification de
Reynaud : il y a tromperie sur l'armistice.
Le
général de Gaulle a parfaitement raison de dire que « La France a perdu
une bataille, mais n'a pas perdu la guerre », en ce sens que la défaite
militaire d'un pays n'est qu'un épisode dans une guerre de coalition. Il a
parfaitement raison d'appeler au combat tous les Français disponibles et de
soulever les territoires périphériques de l'Empire. Mais sa culpabilité
commence, quand, sachant que «l'armistice ne pouvait être évité » comme
il l'avoue au général Odic, il fait croire qu'il est trahison; quand
il donne des clauses de l'armistice, une interprétation qui conduit aux drames
de Mers-el-Kébir et de Dakar, c'est-à-dire à la rupture de relations
diplomatiques entre la France et la Grande-Bretagne, aux cours martiales contre
les Gaullistes, à la division morale des Français. Ce faisant, il détourne de
lui quantité de concours qui se seraient offerts : les Alpins de Béthouart,
retour de Norvège, les évacués de Dunkerque, les équipages des vaisseaux de
guerre pris par surprise dans les ports britanniques. Ces braves gens, il ne les
convainc pas, parce qu'il n'arrive pas à les persuader qu'un Weygand,
qu'un Pétain sont des traîtres.
Eux subodorent dans ses propos quelque chose de louche, le
relent d'une ambition personnelle. Ils préfèrent retourner en France que de
combattre sous la croix de Lorraine. En France la qualification de traîtres
lancée à la radio contre les hommes de Bordeaux, puis contre ceux de Vichy
retient quantité de courages sur le chemin du départ. C'est aux Etats-Unis, non
en Angleterre, que les autorités françaises déjà dépêchent les meilleurs
spécialistes de tanks et d'avions pour en faire bénéficier la nation amie dont
on espère qu'elle entrera tôt ou tard, dans la lutte. Mers-el-Kébir crée dans la
marine française un violent sentiment anti-british, Dakar attise cette fièvre
obsidionale chez les coloniaux qui leur fera prendre pour un commando le
débarquement des Américains sur les côtes marocaines en novembre 1912 et
engendrera après Mers-el-Kébir et Dakar, le drame de Casablanca.
Faux départ, qui, tout de suite, s'aggrave
d'une substitution de rôle.
Le 16 novembre, à Brazzaville, de Gaulle se proclame chef de l'Etat
Français. Il n'est plus un chef militaire occupé à bouter les usurpateurs de
Vichy hors du pouvoir.
Il proclame illégal le gouvernement auprès duquel tous les États, les Etats-Unis
et l'Union Soviétique entre autres, accréditent leurs ambassadeurs.
Telle sera la prétendue base juridique qui lui permettra, lorsqu'il
s'emparera de l'Etat de disqualifier, poursuivre, emprisonner, condamner les
généraux et les amiraux , qui ont cessé le combat, les ministres du Maréchal,
les parlementaires qui lui ont conféré le pouvoir constituant, l'administration
métropolitaine et coloniale qui a exécuté ses décrets-lois, les industriels qui
ont continué à faire tourner leurs usines, les écrivains qui n'ont cessé de
publier, les artistes qui ont continué à exposer ou à jouer, car il fallait que,
pendant quatre ans, la France cessât
de se nourrir, de se vêtir, de produire, de penser, de subsister en un mot,
puisque lui, incarnation de la patrie, assumait toutes ces fonctions à Londres,
par procuration.
Hitler, Mussolini,
cela ça ne l' intéresse pas, ce n' est pas son affaire; mais prendre
Saint-Pierre et Miquelon, dénoncer indûment l'amiral Robert, condamner
l'amiral Decoux sous le fallacieux prétexte d'avoir entraîné la chute de
Singapour en cédant l'Indochine sans combat, discréditer le gouverneur
Boisson sous la fausse accusation d'avoir transformé Dakar en un nid de
sous-marins allemands, exiger le blocus de Madagascar, faire battre à Dakar et
en Syrie ses troupes contre des Français en dépit de l'engagement solennel qu'il
a pris auprès de M. Churchill de n'en rien faire, cela , c'est ce qui le
concerne : la guerre contre Vichy et les Vichyssois. Il va si loin dans cette
voie, qu'il souhaite dans son for intérieur que la France entre en guerre contre
la Grand-Bretagne.
Lorsque le général Odic lui expose que Weygand et lui ont fait en
Afrique du Nord, pour empêcher l'infiltration allemande, sauvegarder l'usage des
bases et comment, à tout prix, il faut empêcher une alliance militaire
franco-allemande, il ne se contient plus : « Il faut au contraire que la
France entre en guerre aux côtés de l'Allemagne, afin de prouver la culpabilité
des hommes de Vichy. »
,
(Cf. Kenneth Pendar Aventure in Diplomacy . p. 201)
Des Français se mêlent-ils de vouloir libérer le pays en dehors de lui, de
préparer le débarquement des Alliés, de lever une armée : Il les dénonce comme
des usurpateurs plus dangereux que les envahisseurs. Il fera mettre
Lemaigre-Dubreuil et Rigault en Résidence surveillée, puis les
laissera emprisonner pendant des mois, sous l'accusation de trahison pour
intelligence avec une puissance étrangère et de franchissement illégal des
frontières(1).
Il fera dénoncer, par sa presse de Londres et de New-York, puis par le général
Catroux, Giraud et son armée comme un chef et une armée fascistes
qui menacent les arrières des troupes anglo-américaines, encore qu'ils se
trouvent engagés en avant, à l'extrême pointe du combat, sur la grande dorsale
de Tunisie. Il organise la débauche des équipages du Richelieu, du Montcalm, des
bâtiments de guerre qui sont venus, de Dakar et de Casablanca, mouiller dans les
ports américains pour se remettre en état de combat; les marins qui signent une
« adhésion au Général » sont dirigés sur Londres via Halifax, Canada. Il fait
tant et si bien qu'un navire, qui avait perdu huit sur dix de ses canonniers,
fut coulé, corps et biens, avec son chargement américain.
[1)
Voir document XXXII
14 MISSION SECRETE
Il organise sur une vaste échelle la
désertion de l'armée de Giraud offrant des primes d'engagement allant
jusqu'à 25 et 30 000 francs et la promesse aux tirailleurs sénégalais de les
renvoyer chez eux immédiatement.
Il dénonce les accords passés avec Giraud qui prévoyaient l'armement des
500.000 coloniaux. Il n'a que faire d'une grande armée nationale qui ne serait
pas sous ses ordres; il rêve d'une petits armée prétorienne qu'il aura bien
en main. Il abaisse la limite d'âge pour éliminer quatre cents généraux et
officiers supérieurs; il en fait disparaître des centaines dans les prisons ou
dans les confins du désert « sahariens », qu'on appelle « la Sibérie du
Gaullisme ».
Il ne songe nullement à réserver pour la libération du territoire l'embryon
d'armée qui nous reste. Six divisions, c'est encore trop pour une armée
prétorienne qui doit servir dans sa pensée, au coup d'Etat. Il l'envoie se faire
décimer dans la campagne d'Italie, « La campagne monstrueuse » comme l'appellera
un officier cinq fois blessé, où, après l'hécatombe de Tunisie, nous perdons
encore vingt-mille hommes. C'est que à vrai dire, la libération ne l'intéresse
pas. Seul le préoccupe, dans les trois mois qui précédent le débarquement sur
les côtes de Normandie, d'être reconnu comme Chef du gouvernement français par
les Alliés.
Pour y parvenir toutes les manoeuvres, tous les chantages in-extremis sont bons.
Le 26 mars 1944, il rompt les pourparlers avec les alliés concernant le
ravitaillement de la France : « Reconnaissez-moi ou bien une fois délivrés,
les malheureux Français auront à attendre de longs mois vos secours jusqu'à ce
que leur détresse vous oblige à céder. » Le 2 avril, il notifie aux Alliés,
les dispositions administratives et politiques qu'il a prises, en violation de
toutes ses promesses d'appliquer, la loi
Tréveneuc
pour substituer, au fer et à mesure de la libération de la métropole, son
autorité à celle de l'administration existante. Le 6 mai, comme il n' y a
toujours pas de reconnaissance il suspend toutes conversations avec les Alliés;
c'est une véritable rupture de relations diplomatiques. Le 3 juin, il proclame,
par un acte unilatéral, le Comité d'Alger « Gouvernent de la République
Française. »
Depuis le 2 mai, M. Churchill qui voit le jour J approcher, fait savoir à
de Gaulle que sa place est à Londres. Il y arrive, le 5, sans se presser.
On le met au courant des décisions prises pour le lendemain. Alors, intervient
le suprême chantage. De Gaulle menace de ne pas se joindre aux Chefs des
autres gouvernements dans leurs broad-casts à l'Europe, à moins qu'on n'entérine
ses décisions. Le Premier Ministre doit le menacer de le renvoyer en avion en
Algérie et d'aller dire aux Communes que le général de Gaulle a refusé de
parler au peuple Français au moment où les soldats américains, anglais,
canadiens, polonais vont verser leur sang pour libérer le sol de sa patrie.
Cinq heures après les autres, furieux, il s'y résigna, mais c'est pour prendre
1e contre-pied des recommandations d'Eisenhower. Celui-ci a dit en
substance : « Français, je suis le Commandant en chef, obéissez-moi » ;
de Gaulle :« vous ne devez obéir qu'à moi »; Eisenhower :
« Quand vous serez libérés, vous aurez à choisir vous même votre
gouvernement »; de Gaulle : « Vous n'aurez rien à choisir du tout,
je suis d'ores et déjà votre gouvernement » .; Eisenhower : « Pas
de soulèvement prématuré pour éviter de verser un sang inutile » ; de
Gaulle : « Le devoir de tout Français est de se battre sans attendre. »
Pendant que le général Eisenhower livre une bataille sanglante et encore
indécise, de Gaulle s'irrite et polémique à Londres au sujet de
l'administration des territoires libérés. Ce n'est pas en stratège, c'est un
procédurier. Comme on ne lui donne pas encore entière satisfaction, il refuse le
concours de centaines d'officiers français réunis à Londres; il n'autorise que
le départ symbolique de vingt officiers de liaison, la participation de de
Gaulle à la bataille de Normandie est de vingt officiers de liaison et de
deux bataillons de parachutistes
au
bout de quatre ans de préparation et après des milliards de francs-or dépensés.
C'est que peu lui importe l'issue plus ou moins rapide de la bataille : ce qui
le passionne, c'est la démission du maire de Bayeux.
Il
est vrai qu'en Alger il a déclaré qu'il ne se considérait plus comme chef
militaire, mais comme homme politique.
Homme politique,
son premier acte a été de détruire la légalité constitutionnelle.
Ce faisant il dû prendre la mentalité d'un usurpateur.
Tout usurpateur doit se défendre contre la concurrence, avouée ou soupçonnée, de
chacun de ses pairs qui pourrait être tenté de dire :
« Pourquoi pas moi plutôt que lui ! » Darlan est assassiné.
Giraud subit plusieurs « accidents », puis essuie, un attentat dont sa
baraka le sauve, non sans dommage pour sa mâchoire. De Gaulle arrive
finalement à l'évincer de la co-présidence du Comité d'Alger en vertu de la loi
de 1938 relative à l'organisation de la nation en temps de guerre qui interdit
le cumul des pouvoirs civils et militaires, cumul qu'il s'attribuera lui même
peu après en interprétant d'une façon inverse la même loi. Cela fait, par une
série de subterfuges qui sont autant de parole, violées, il expulse
Giraud de l'armée. Le général Catroux, a rêvé de jouer le rôle
d'arbitre entre de Gaulle et Giraud : Il sera envoyé à Moscou à un
poste auquel rien ne l'habilite, sinon la distance. Juin, couvert de
gloire eu Tunisie et en Italie, se voit refuser l'honneur de commande sur le sol
de France, parce qu'il a servi sous Vichy, Leclerc est plus acclamé que
de Gaulle sur les écrans de la capitale : de Gaulle l'envoie avec
sa division blindée eu Indochine, se privant ainsi de la seule division dont il
soit sûr, lorsqu'il envisage, vers la mi-janvier, un coup de force.
Tout usurpateur
craint toujours de voir décliner sa popularité, fondement unique de son pouvoir;
aussi est-il astreint à une politique de prestige. De Gaulle n'échappe
pas à la loi du genre. Mais sa politique, de « grandeur » s'exerce
toujours au détriment du pays, quand elle n'aboutit pas aux échecs les plus
humiliants.
-Lui qui a
écrit que l'armés de l'avenir doit se réduire à cent cinquante mille homme,
-lui qui à empêché par ses intrigues le président Roosevelt de
réaliser le projet de Giraud de lever la grande armée africaine, parce
que cette armée n'eût pas été la sienne, sitôt installé au pouvoir il réclame
une armée d'un million d'hommes qu'il dote d'un armement absolument désuet à
l'époque de la bombe atomique, mais qui absorbe par priorité toutes les
disponibilités en acier, en tissu, en vivres, en camion qui eussent permis la
reprise économique ou soulagé la population.
-Lui, qui est allé à Moscou et s'est fait célébrer comme le « plus dur » des
négociateurs, est lâché sitôt après par Staline à Yalta, à Potsdam, à
Londres, à Moscou de la façon la plus désinvolte.
-Lui qui, faisant acte de souveraineté sans en avoir aucun mandat, a proclamé
l'indépendance de la Syrie et du Liban pour les ravir aux Vichyssois, tente de
reprendre de la main gauche ce qu'il a cédé de la main droite, et nous aliène
définitivement ces Echelles du Levant, avec la suprême humiliation de voir, les
troupes françaises gardées par des troupes anglaises pour les protéger contre la
populace déchaînée par le bombardement stupide de Damas.
-Lui, qui a refusé les secours de l'UNRRA, qui a rompu les négociations pour le
ravitaillement de la France, qui a fait fi des facilités du lendlease lorsqu'il
s'offrait largement, qui a repris à son compte la devise de Maurras :
« La France, la seule France », est obligé d'envoyer missions sur
missions aux Etats-Unis et de venir lui-même quémander un emprunt, une fois que
l'heure psychologique est passée.
-Lui, qui a refusé par superbe de voir le président Roosevelt moribond au
retour de Yalta, demande d'être présent à ses funérailles, ce que la famille
politique sèchement lui refuse. Sa politique de grandeur est une politique
de surenchère verbale - qui peut chatouiller délicieusement le complexe de
supériorité des Français, mais qui ne compte que des échecs ou, du moins,
n'obtient de justesse que le minimum de ce que tout français eût à coup sûr
obtenu.
Ayant détruit la constitution, bouleversé l'administration, il lui faut payer
les frais d'établissement du nouveau régime. Les frais sont élevés, car ayant
fait appel à l'intérêt pour arriver, les dents des associés sont devenues
longues. Tous les maquisards, de la première ou de la treizième heure, les
véritables et les simulateurs, les combattants et les terroristes, ceux du
plateau de Glières comme ceux du marché noir, revendiquent places et sinécures.
Pour s'en faire une clientèle, il triple, quadruple quintuple le nombre de
fonctionnaires, envoie à l'étranger d'innombrables missions qui se contredisent,
se contrecarrent et donnent l'impression que leur inexpérience n'a d'égale que
1eur prétention. Il installe 1a bureaucratie la plus nombreuse, la plus
incompétente, 1a plus vénale que la France ait connue au cours de son histoire,
ce qui fait écrire, dans temps présent à un des
zélateurs de la première heure M. Yves Farge, commissaire de la
République pour les huit départements de la région Rhône-Alpes : « je
pars épouvanté : sur notre pays malade, un monstre s'est assoupi. En quittant ce
commissariat de la République, j'emporte l'image d'un désordre inextricable,
d'un monde administratif chaotique dont il est impossible de dire comment on
pourra, autrement que par le feu, se débarrasser pour obtenir une vision exacte
et synthétique de la vie française, de ses malheurs, de ses besoins, et sans
laquelle l'Etat restera incapable de mettre un terme à l'aventure .»
Pour
payer ses créatures, il faut faire fonctionner « la pompe à phynances ».
Au temps de l'occupation, la Banque de France virait quotidiennement au compte
des autorités occupantes la somme de 400 puis 300 millions de
francs.
Au
temps de de Gaulle, la planche à billets imprime pour un milliard de
francs par jour.
Du 7 mars 1940 au 28 décembre 1940, le stock d'or de la Banque de France est
demeuré inchangé à 1778 tonnes;
au
bilan du 20 décembre 1945, il n'en restait que plus que 968 tonnes : 40% du
stock d'or en poids avait disparu.
Les nationalisations précipitent la chute des valeurs en Bourse. La dévaluation
de 1a devise nationale est imputée comme un enrichissement sur lequel s'abat
l'impôt de péréquation. La poursuite des bénéfices de guerre se transforme en
une véritable inquisition fiscale qui paralyse les chefs d'industrie. Les
conseils d'usines tendent à se substituer à la direction des entreprises.
Celles-ci se voient entravées dans un tel réseau de règlements qu'elles doivent
vivre dans l'illégalité ou fermer. Les réserves sociétaires s'épuisent. Le
capital privé disparaît. A la formule de 48 : « la propriété, c'est le vol » se
substitue un slogan nouveau : « la propriété, c'est la collaboration, », ce qui
permet de décapiter en partie les classes dirigeantes et techniques. Une
véritable révolution sociale se dessine, tendant à substituer à l'économie de
marché l'économie planifiée par l'Etat et mettant l'État entrepreneur dans
l'obligation, pour être rentable, de devenir totalitaire.
Partie 4
|